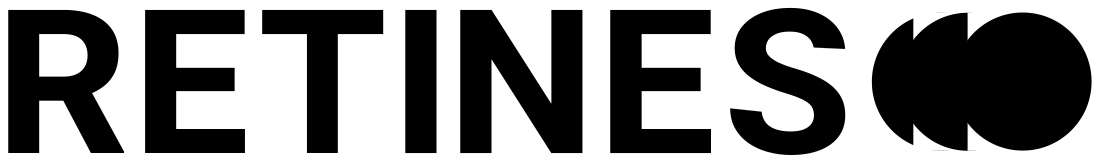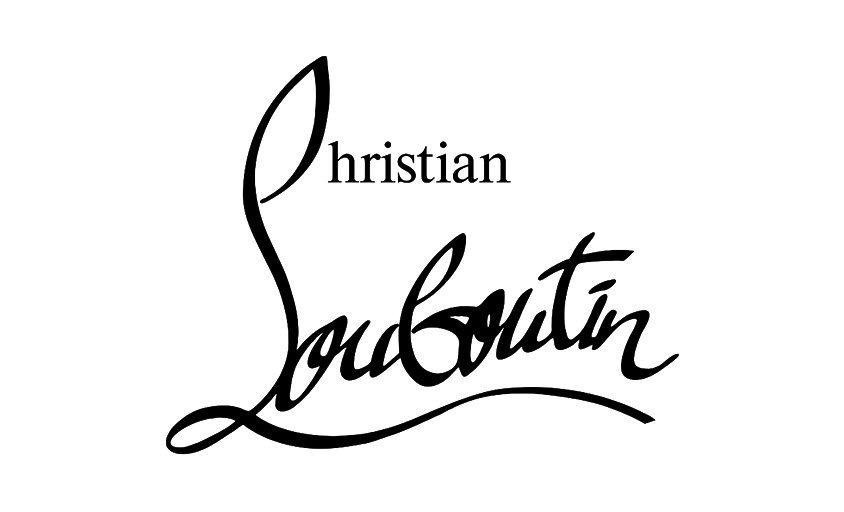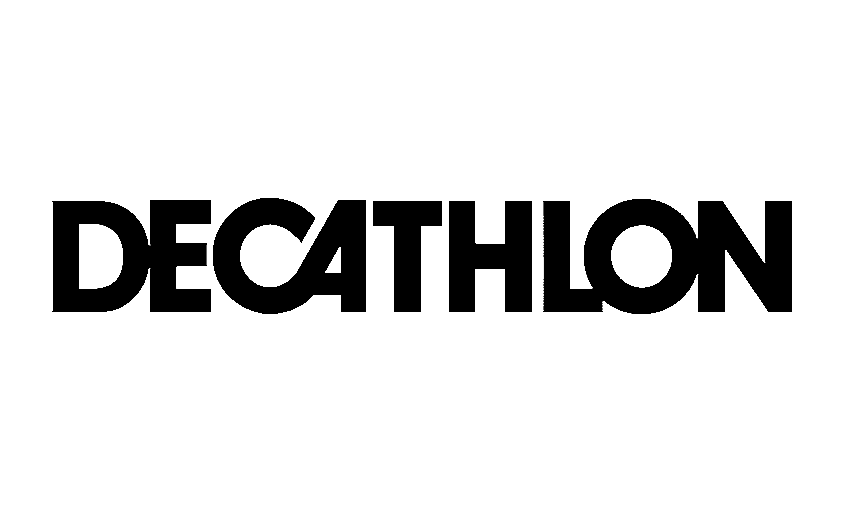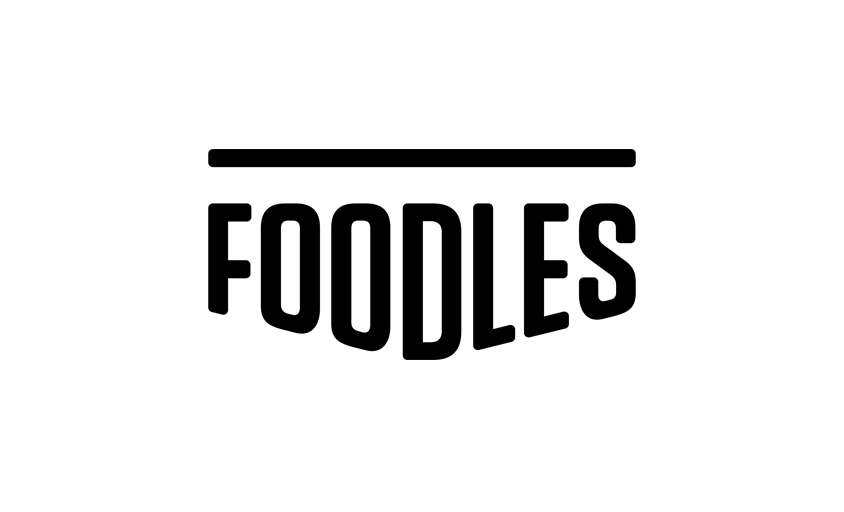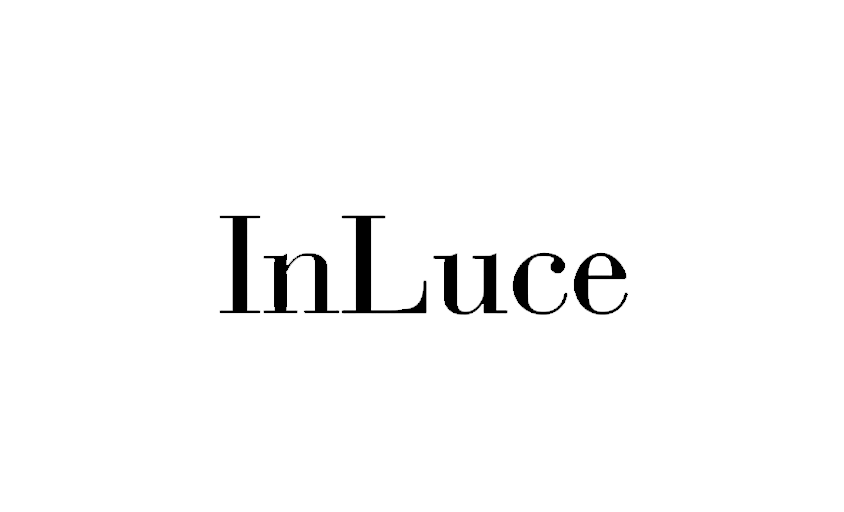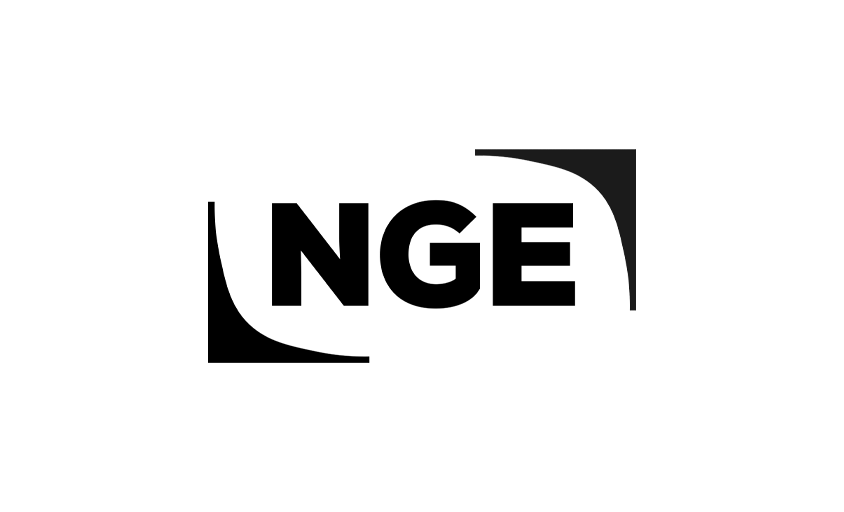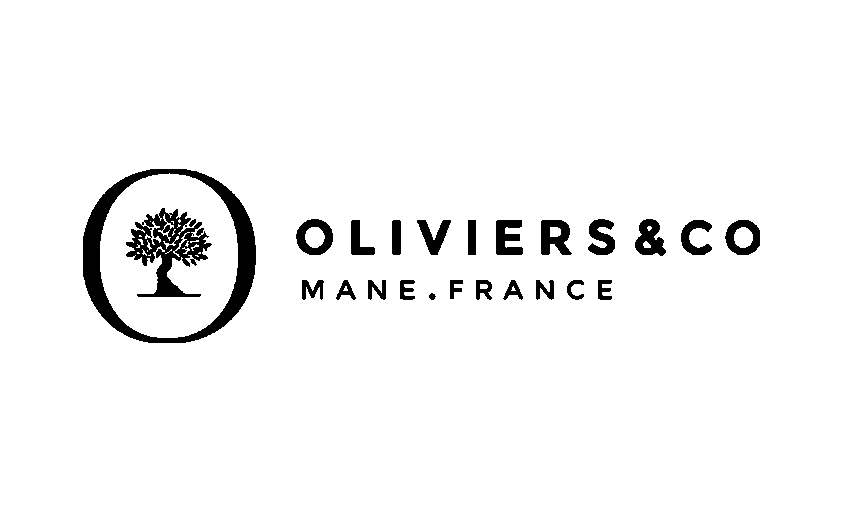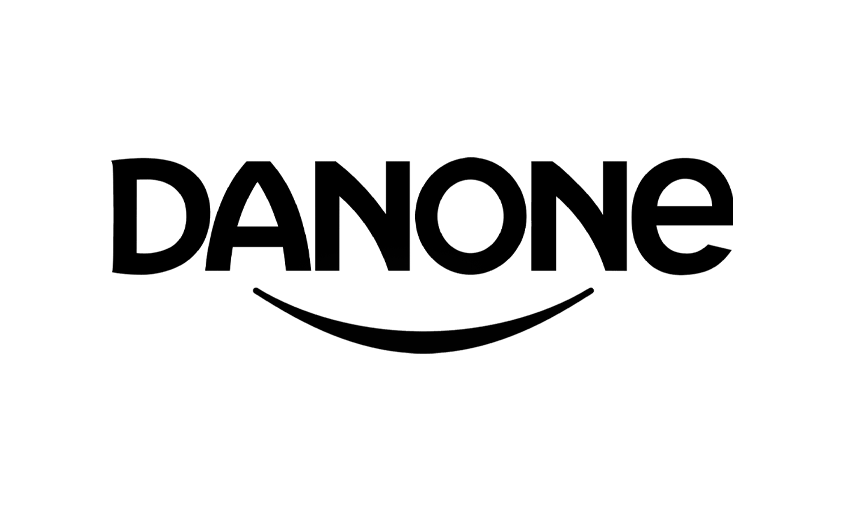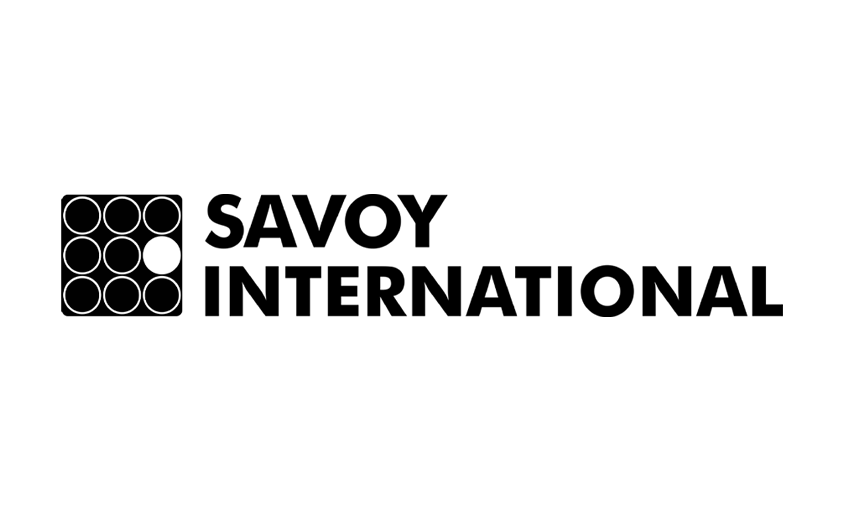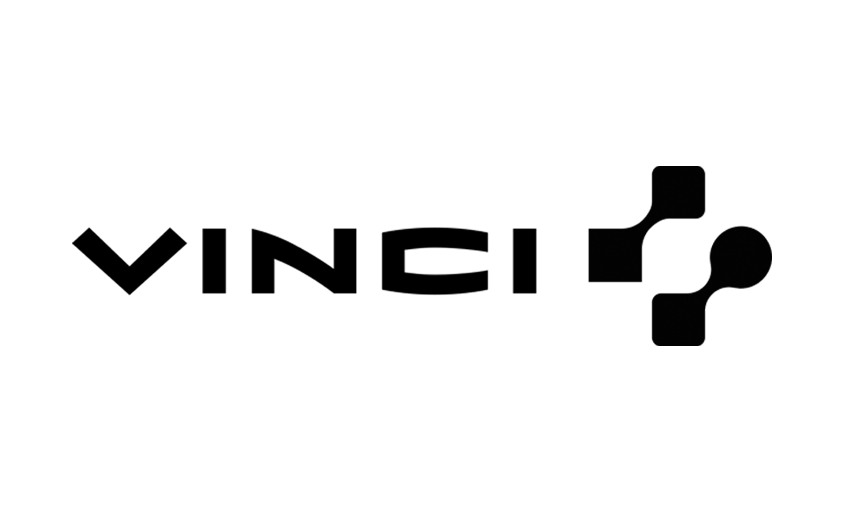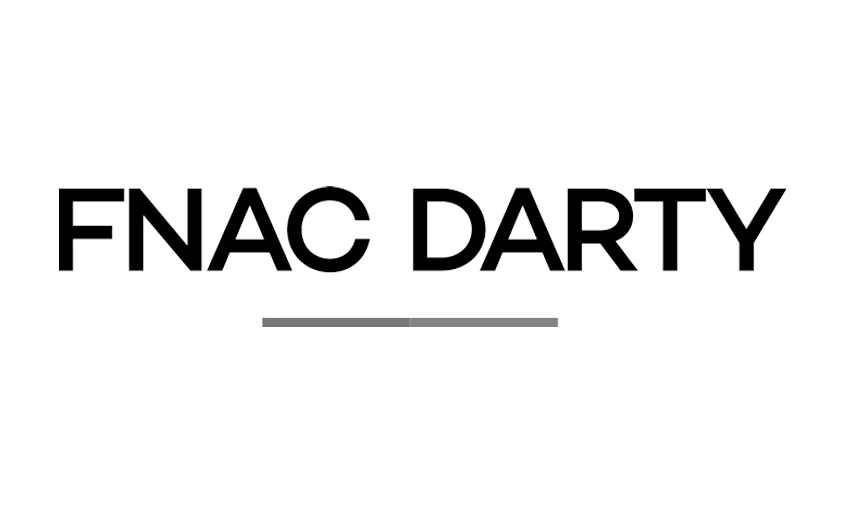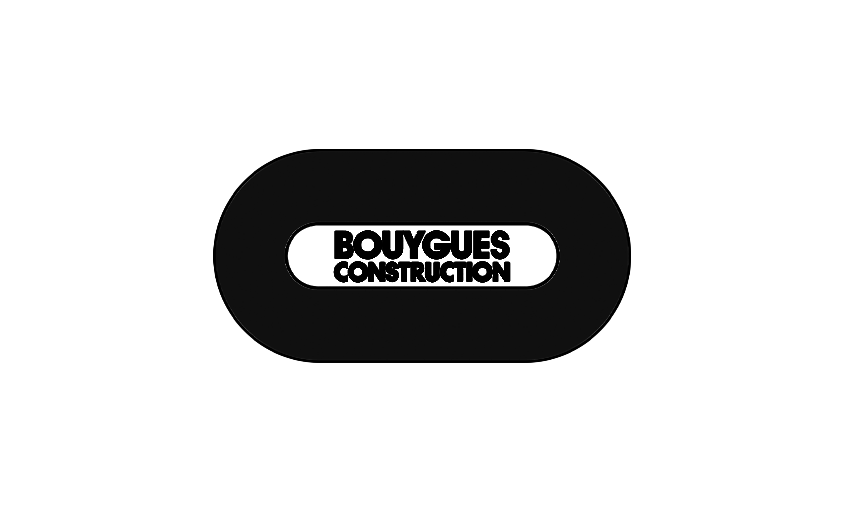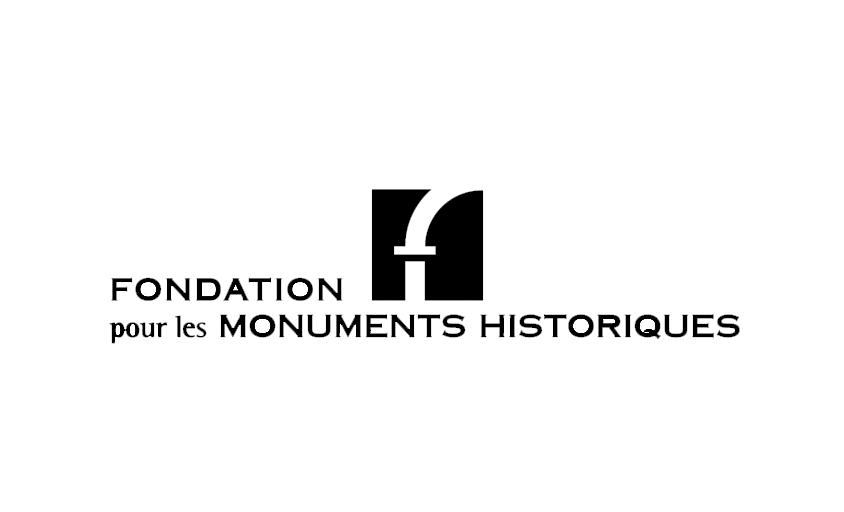Le Cadre Légal de la Photographie Médicale
Dans cet article :
La photographie médicale est aujourd’hui un outil indispensable dans la pratique médicale et esthétique. Elle permet de documenter les cas cliniques, de suivre l’évolution d’un traitement, mais aussi de valoriser le savoir-faire des praticiens. Pourtant, dès qu’une image représente un patient, elle devient un donnée personnelle sensible, soumise à un cadre légal strict.
Entre respect du droit à l’image, protection des données de santé et autorisation de diffusion, le photographe comme le professionnel de santé doivent naviguer avec prudence. Comprendre la législation en vigueur, c’est garantir non seulement la conformité juridique, mais aussi la confiance et la transparence envers les patients.
1. La photographie médicale
Les photographies médicales ne sont pas de simples images : elles appartiennent au domaine du secret médical. Le Code civil et le Code pénal encadrent clairement leur usage, leur conservation et leur diffusion.
L’article 9 du Code civil établit un principe fondamental :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Cela inclut le droit à l’image, c’est-à-dire le droit pour toute personne de contrôler la reproduction et la diffusion de son visage ou de toute partie de son corps.
Ainsi, toute prise de vue identifiable d’un patient nécessite une autorisation explicite.
Le Code pénal (article 226-1) renforce ce principe en prévoyant des sanctions pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas d’atteinte à la vie privée par captation, enregistrement ou diffusion d’images sans consentement.
En parallèle, le Code de la santé publique protège la confidentialité des données médicales. Les photographies prises dans un cadre clinique font partie intégrante du dossier patient et doivent être stockées et utilisées selon les standards du secret professionnel.
2. Le consentement du patient
Aucune photographie médicale ne peut être réalisée ni utilisée sans consentement préalable et éclairé du patient. Ce principe s’applique dès la prise de vue, mais aussi lors de toute réutilisation ultérieure : communication scientifique, formation, ou diffusion à des fins promotionnelles.
Deux types de consentement coexistent :
- Le consentement implicite, applicable lorsque la photo est intégrée au dossier médical, uniquement pour le suivi du traitement ou à des fins diagnostiques internes.
- Le consentement explicite, exigé dès que l’image quitte le cadre médical (publication, site web, communication professionnelle, congrès, etc.). Il doit être formalisé par écrit, signé par le patient (ou ses représentants légaux s’il s’agit d’un mineur).

Avant la séance photo, le praticien ou le photographe doit informer clairement le patient de :
- La finalité de la photographie (suivi, communication, publication)
- Les supports sur lesquels elle pourra apparaître
- Les droits du patient à retirer son consentement à tout moment
Cette démarche garantit une transparence totale et protège à la fois le patient et le professionnel.
3. L’anonymat : un pilier de la photographie médicale éthique
Lorsque le visage ou un signe distinctif (tache, cicatrice, tatouage, bijou) apparaît, l’image devient identifiable.
Dans ce cas, il est impératif de préserver l’anonymat du patient. Cela passe par :
- Le recadrage de l’image pour exclure tout élément reconnaissable.
- Le floutage des zones identifiantes.
- L’utilisation d’un fond neutre et uniforme.
Une photographie parfaitement anonyme peut, dans certains contextes (articles scientifiques, études de cas), être utilisée sans autorisation spécifique.
Cependant, sur le plan éthique, il reste préférable d’informer le patient, même lorsque l’anonymisation est complète. La confiance repose autant sur la légalité que sur la transparence.
4. L’usage et la diffusion
L’utilisation d’une photo médicale ne se limite plus aux seuls dossiers patients. Les professionnels de santé communiquent désormais sur leur expertise via des sites web, réseaux sociaux ou publications professionnelles. Cette évolution impose un équilibre délicat entre valorisation et respect du cadre légal.
- En communication scientifique : les photos peuvent illustrer un cas clinique dans un article ou une conférence, à condition d’obtenir le consentement écrit du patient.
- En communication commerciale ou promotionnelle : une vigilance accrue s’impose. Les images diffusées sur un site de cabinet ou sur les réseaux sociaux relèvent de la publicité médicale, régie par le Code de la santé publique.
Les photographies doivent être fidèles, non trompeuses et conformes à la réalité des soins réalisés. Toute mise en scène ou retouche excessive pourrait être assimilée à une publicité mensongère. - En interne : la photo médicale reste un outil de travail essentiel (comparatifs avant/après, suivi post-opératoire), mais elle doit être stockée sur des serveurs sécurisés et conformes RGPD.

5. Responsabilités partagées : praticien, photographe et patient
La conformité légale ne repose pas uniquement sur le praticien. Le photographe professionnel intervenant dans un environnement médical a lui aussi des obligations précises.
Il doit :
- Garantir la confidentialité des fichiers et la sécurité du stockage (disque chiffré, transfert sécurisé).
- Respecter le secret professionnel s’il assiste à des actes médicaux.
- Livrer les images uniquement au praticien ou à la structure médicale commanditaire, jamais directement au patient sans autorisation.
Le photographe devient alors un partenaire de confiance, qui comprend les enjeux juridiques et éthiques du secteur médical, et adapte sa méthode de travail en conséquence.
6. Le RGPD et la photographie médicale
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les photographies médicales sont considérées comme des données de santé à caractère personnel.
Cela implique plusieurs obligations :
- Obtenir et conserver la preuve du consentement.
- Définir la durée de conservation des images.
- Garantir le droit à l’oubli du patient, c’est-à-dire la suppression de ses données sur demande.
- Sécuriser les transferts et le stockage des fichiers (hébergement certifié HDS recommandé).
Un cabinet dentaire ou un chirurgien esthétique doit donc intégrer la photographie médicale dans sa politique RGPD interne, au même titre que tout autre document de santé.
7. Conclusion
La photographie médicale, qu’elle soit clinique, esthétique ou documentaire, repose sur un équilibre subtil : scientifique, artistique et juridique.
Bien maîtrisée, elle valorise l’expertise du praticien tout en respectant la dignité du patient.
Mal encadrée, elle peut devenir source de litiges, voire de sanctions pénales.
Collaborer avec un photographe spécialisé dans le secteur médical, c’est s’assurer d’un partenaire conscient des enjeux légaux, respectueux de la confidentialité et capable de produire des images précises, fidèles et conformes au cadre réglementaire.
Rétines, partenaire visuel des professionnels de santé
Chez Rétines, nous accompagnons les praticiens et établissements de santé dans la création d’images conformes, esthétiques et sécurisées.
Nos shootings sont réalisés dans le strict respect du cadre légal et de la confidentialité médicale, tout en valorisant la dimension humaine et esthétique de chaque pratique.
📸 Besoin d’un photographe spécialisé dans la médecine ou l’esthétique ?
Contactez notre équipe pour des visuels professionnels, précis et juridiquement sûrs.
Jérémy Carlo est responsable de publication chez Rétines, où il veille avec l'équipe Rétines à la cohérence éditoriale de l’ensemble des contenus produits par le studio.
Contact
Nous sommes à votre disposition.
Briefez-nous grâce à ce formulaire, ou bien par e-mail à [email protected].