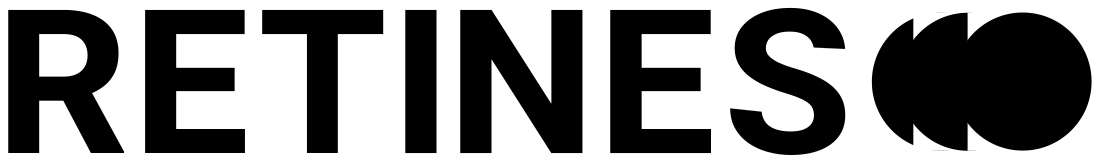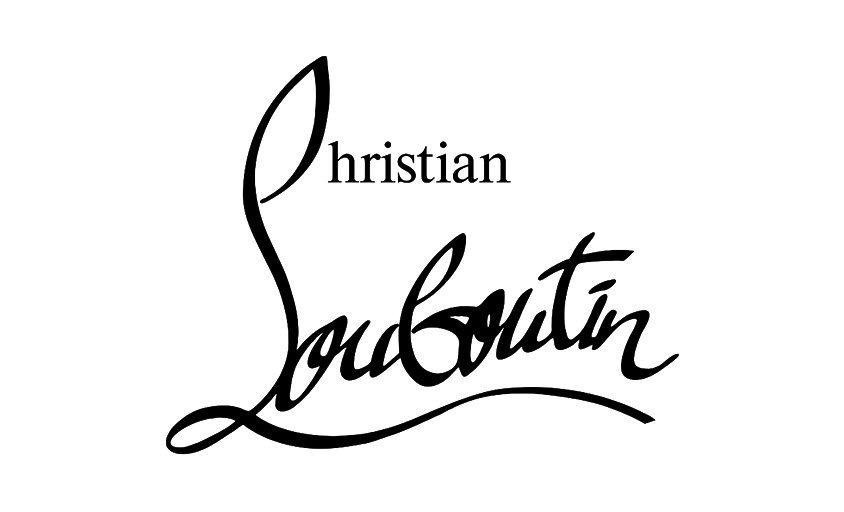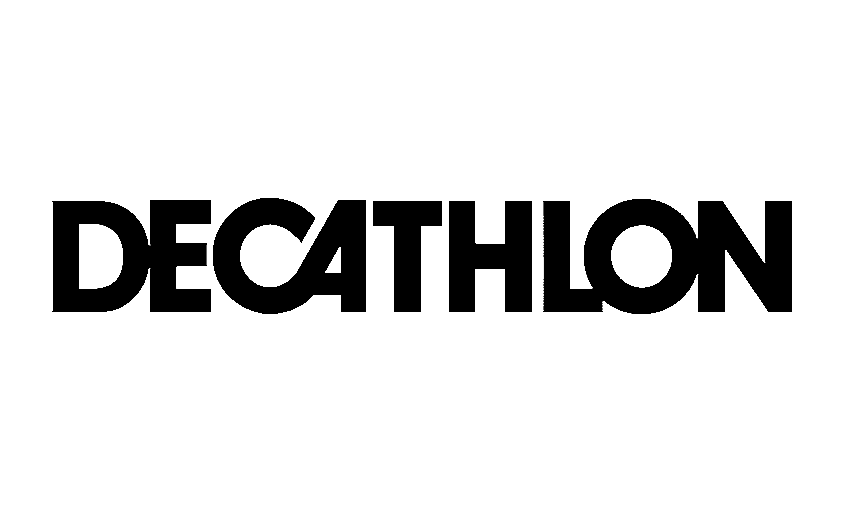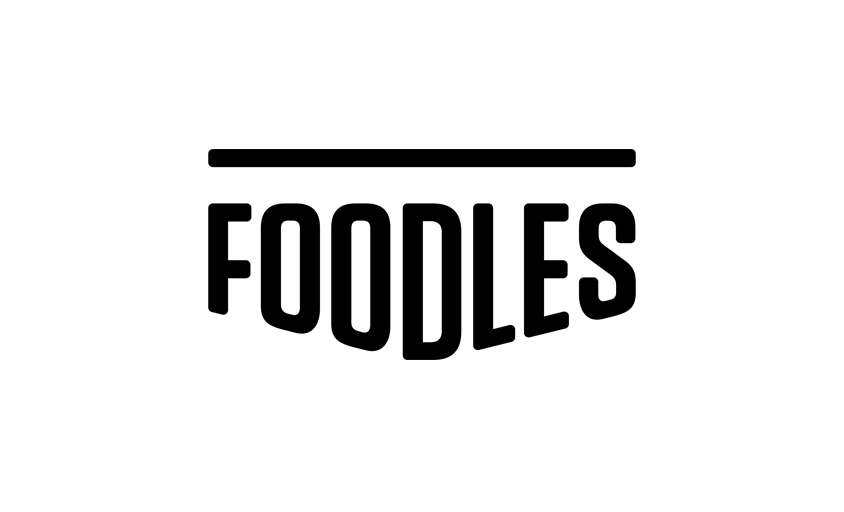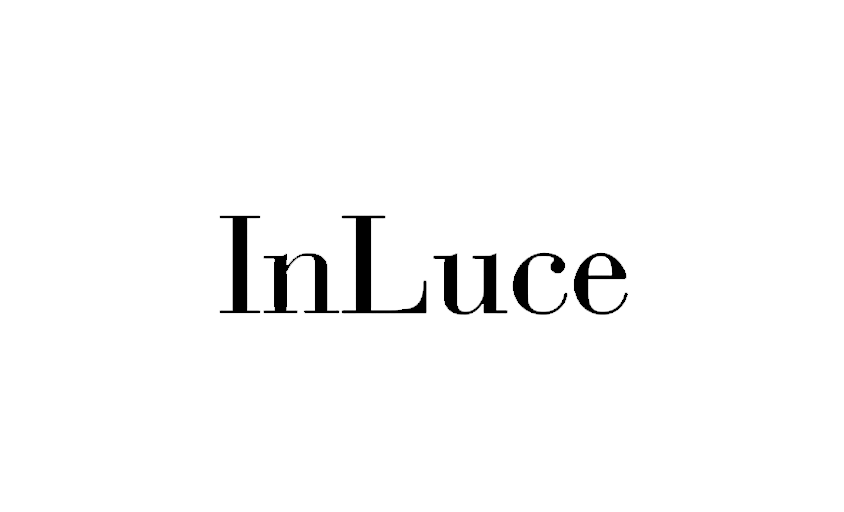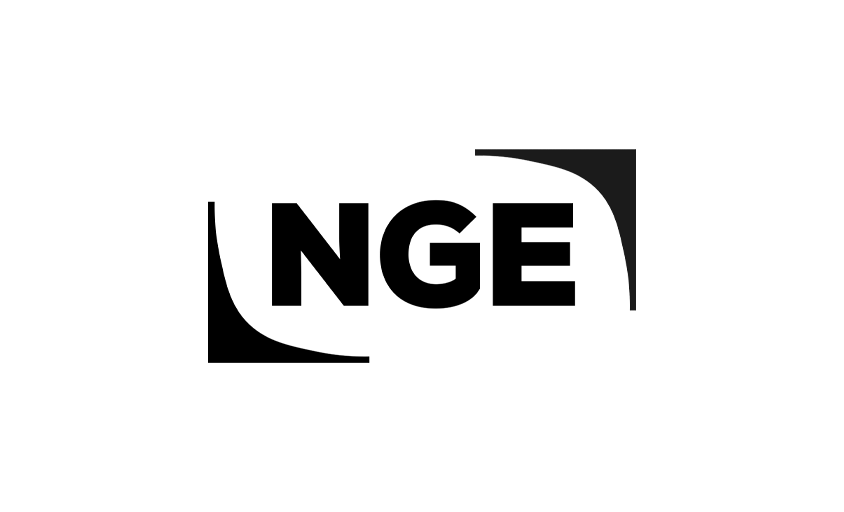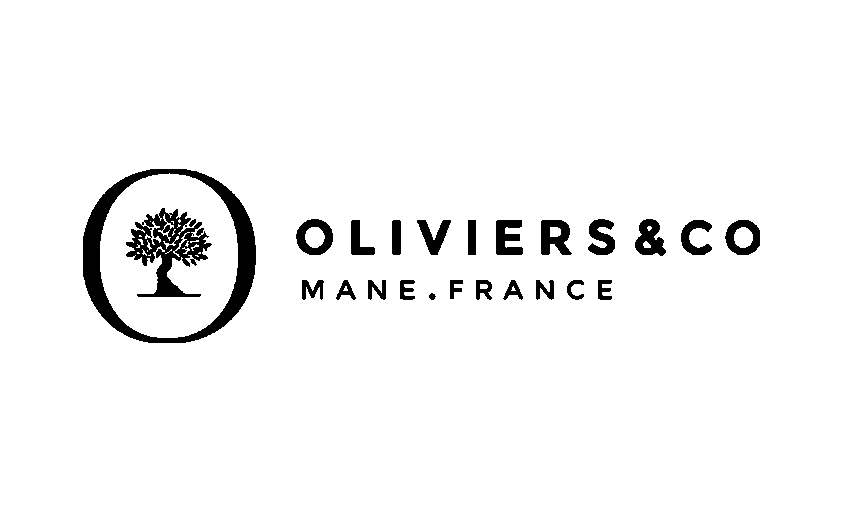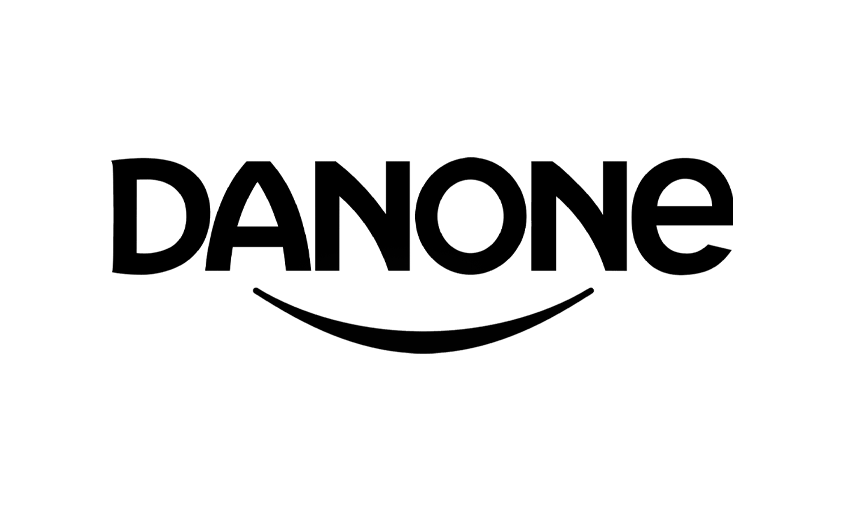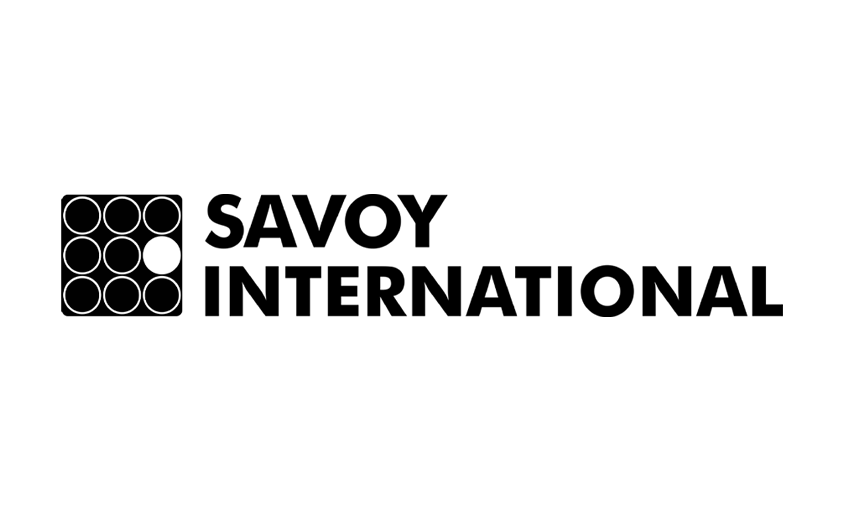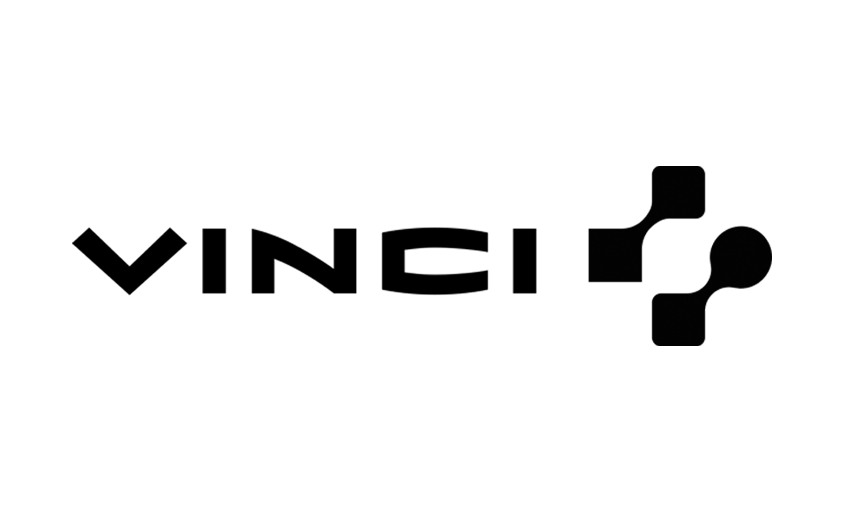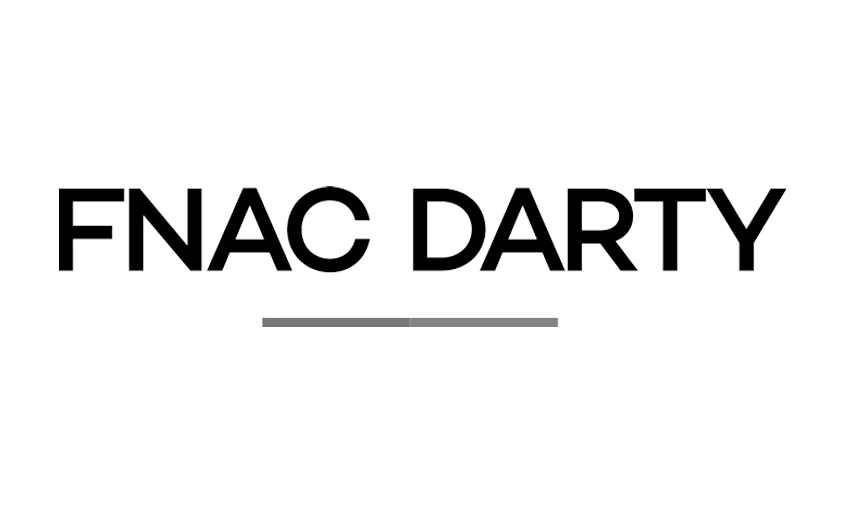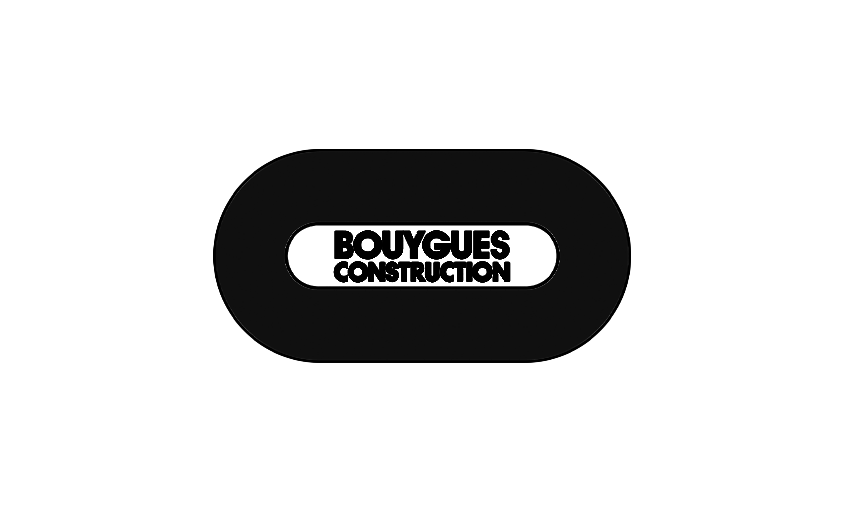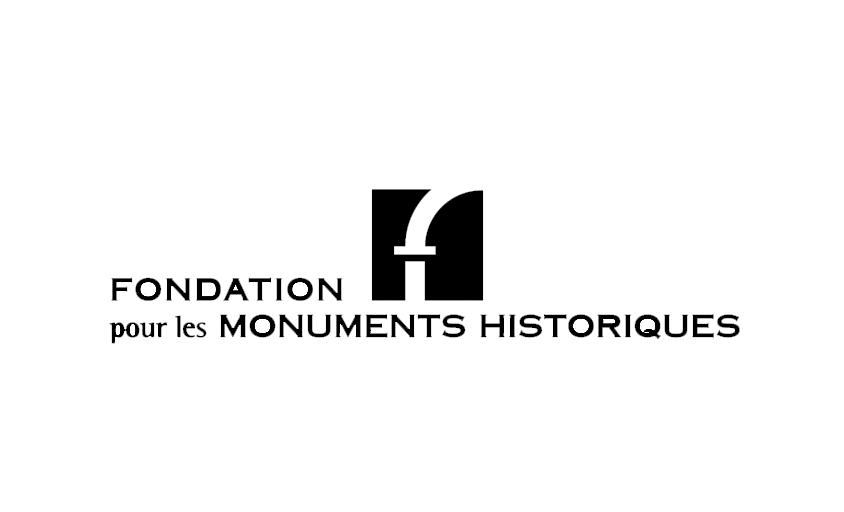Les Droits à l’Image des Bâtiments : Ce Que Dit la Loi en France
Dans cet article :
Peut-on photographier un bâtiment librement et diffuser son image sans autorisation ? En photographie d’architecture, la question du droit à l’image soulève de nombreuses zones d’ombre. Entre protection du droit d’auteur des architectes, autorisation des propriétaires, et limites de la liberté de panorama, les règles varient selon les usages. Cet article fait le point sur ce que dit la loi en France, avec des exemples concrets et des conseils pratiques pour les photographes, les agences et les entreprises qui souhaitent utiliser des images de bâtiments en toute légalité.
1. Droit d’auteur et architecture : une œuvre protégée ?
Tous les bâtiments ne sont pas simplement des constructions utilitaires : certains relèvent d’une démarche artistique et intellectuelle, relevant ainsi du droit d’auteur. En France, le Code de la propriété intellectuelle reconnaît que les œuvres architecturales peuvent être protégées en tant qu’œuvres de l’esprit au même titre qu’une photographie, un roman ou une sculpture.
L’architecte, en tant qu’auteur de l’ouvrage, bénéficie donc des droits patrimoniaux et moraux attachés à son œuvre. Cela signifie qu’il peut revendiquer la paternité de la création, s’opposer à des modifications qui en dénatureraient l’esprit, et en autoriser ou non la reproduction, y compris sous forme de photographies diffusées publiquement.
Attention toutefois : cette protection ne s’applique pas à tous les bâtiments. Pour être couverte par le droit d’auteur, la création architecturale doit être originale, c’est-à-dire porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Un bâtiment purement fonctionnel ou standardisé (immeuble HLM, hangar industriel, pavillon sans singularité) ne remplit généralement pas ces critères.
Enfin, la protection s’étend jusqu’à 70 ans après le décès de l’architecte. Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public — mais cela ne signifie pas nécessairement une liberté totale d’exploitation (cf. droit à l’image du propriétaire).
2. Le droit à l’image d’un bâtiment : un droit du propriétaire ?
Contrairement aux personnes physiques, les bâtiments ne disposent pas, en tant que tels, d’un droit à l’image absolu. Le principe juridique, confirmé par la jurisprudence, est que le propriétaire d’un bien ne peut s’opposer à sa représentation photographique, sauf dans des cas très particuliers.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de ce bien » (arrêt du 7 mai 2004, affaire Canal+). Il ne peut donc interdire une prise de vue extérieure de sa propriété, tant qu’elle ne porte pas atteinte à sa vie privée ou ne cause pas de trouble particulier.
Cependant, certaines situations nécessitent vigilance :
- Si la prise de vue porte atteinte à la vie privée (vue plongeante sur une propriété privée, éléments personnels visibles),
- Si l’image du bâtiment est utilisée de manière commerciale sans autorisation (publicité, packaging, merchandising),
- Ou si la diffusion engendre un trouble anormal, par exemple une association à des contenus polémiques ou une exploitation massive de l’image sans contrepartie.
Autrement dit, le simple fait de posséder un bâtiment ne donne pas le droit d’interdire qu’il soit photographié, mais le contexte de l’exploitation peut faire naître un litige.
3. Cas pratiques : peut-on photographier un bâtiment et utiliser la photo ?
La photographie d’architecture suscite souvent des interrogations concrètes : dans quels cas peut-on photographier un bâtiment et diffuser l’image sans autorisation ? La réponse varie selon l’usage envisagé, le statut du bâtiment et les personnes impliquées dans le processus de création.
a. Photographie pour usage privé ou artistique
Si vous photographiez un bâtiment dans un cadre privé, non commercial ou artistique, aucun cadre légal spécifique ne vous interdit de le faire, sauf atteinte manifeste à la vie privée (vue intérieure, détails personnels).
L’usage purement personnel (portfolio, exposition d’auteur, blog personnel sans but lucratif) est largement toléré, même si le bâtiment est protégé par le droit d’auteur. La jurisprudence considère que la liberté d’expression artistique prime tant qu’il n’y a pas d’exploitation commerciale directe.
Toutefois, dès qu’il s’agit de publier largement une photographie (réseaux sociaux, livre, exposition publique), la prudence reste de mise, notamment si l’architecte est identifiable ou encore en vie.
b. Photographie à but commercial ou éditorial
Les usages commerciaux (affiches, campagnes publicitaires, catalogues, packagings, illustrations de produits) ou éditoriaux à fort tirage (presse, livres vendus, banques d’images) nécessitent davantage d’attention.
Dans ce cadre, deux risques juridiques principaux se présentent :
- Une violation du droit d’auteur, si le bâtiment est une œuvre protégée et que l’image reproduit de façon reconnaissable l’ensemble ou des éléments distinctifs de sa création ;
- Une atteinte aux intérêts du propriétaire, si l’image est exploitée sans autorisation dans un but lucratif, surtout si le bâtiment a une forte valeur symbolique (musée, monument contemporain, architecture de marque…).
Par exemple, intégrer la photo d’un bâtiment emblématique dans une publicité sans autorisation explicite de l’architecte ou du propriétaire pourrait entraîner des poursuites pour utilisation abusive de l’image.
c. L’architecte est-il photographe ou tiers ?
Un point souvent ignoré concerne le rôle de l’architecte lui-même. Peut-il photographier et diffuser librement son propre bâtiment ? En principe, oui, puisque l’auteur d’une œuvre conserve un droit d’usage sur sa création, y compris pour sa promotion ou sa communication.
Mais si l’architecte a cédé ses droits ou si le bâtiment appartient à une entité privée ou publique ayant imposé des restrictions contractuelles (comme un musée ou un groupe immobilier), une autorisation du propriétaire peut s’avérer nécessaire.
Quant au photographe tiers (freelance, agence, salarié), ses droits sont régis par :
- le contrat de commande (transfert ou cession de droits),
- et le respect du droit d’auteur de l’architecte si l’ouvrage est protégé.
La simple détention d’une photo d’un bâtiment ne garantit donc pas automatiquement le droit de la publier à des fins commerciales, sauf si les autorisations adéquates ont été obtenues.
4. La liberté de panorama : exception ou liberté ?
La liberté de panorama est une notion juridique qui permet, dans certains pays, de reproduire et de diffuser librement des œuvres situées dans l’espace public, comme des bâtiments, sculptures ou installations artistiques. En théorie, cette exception constitue un levier important pour les photographes d’architecture. En pratique, la France applique cette liberté de manière très restrictive.
En droit français, l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que certaines reproductions d’œuvres sont autorisées sans l’accord de l’auteur, notamment dans le cadre de citations, de revues de presse ou d’usages pédagogiques. Toutefois, la liberté de panorama ne figure pas explicitement parmi ces exceptions générales.
Depuis une réforme en 2016, une exception très limitée a été introduite à l’article L122-5-11° : elle autorise la reproduction et la représentation d’œuvres d’architecture ou de sculpture placées en permanence dans l’espace public, mais uniquement à des fins non commerciales. Cela signifie que :
- Une photo postée sur un blog personnel ou un réseau social sans but lucratif est tolérée ;
- Une utilisation commerciale (vente, publicité, illustration de produit) nécessite toujours une autorisation de l’auteur (ou de ses ayants droit).
La situation diffère dans d’autres pays. En Allemagne ou au Royaume-Uni, la liberté de panorama est bien plus étendue : les photographes peuvent librement vendre ou publier des images de bâtiments ou sculptures visibles depuis la voie publique, y compris à des fins commerciales.
Pour les professionnels français, cette différence constitue un piège courant : photographier une œuvre dans l’espace public ne signifie pas automatiquement qu’on peut la commercialiser sans contrainte. En cas de doute, mieux vaut se référer à la législation locale ou obtenir une autorisation.
5. Conseils pratiques pour les photographes et les entreprises
Face à la complexité du droit d’image appliqué à l’architecture, il est essentiel d’adopter de bonnes pratiques professionnelles, que l’on soit photographe, commanditaire ou utilisateur d’images. Voici les principaux réflexes à adopter pour sécuriser vos prises de vue et leur diffusion.
a. Identifier les bâtiments protégés
Avant de photographier un bâtiment à des fins commerciales, posez-vous les questions suivantes :
- Le bâtiment est-il original ou emblématique ?
- Est-il l’œuvre d’un architecte reconnu (contemporain ou récemment décédé) ?
- Est-il situé dans un lieu privé ou réglementé (musée, parc à accès restreint, propriété d’une entreprise…) ?
Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que l’ouvrage soit protégé par le droit d’auteur, ou que sa diffusion soit soumise à des restrictions contractuelles.
b. Demander les autorisations nécessaires
Dans le doute, adoptez une démarche proactive :
- Contactez l’architecte ou son agence pour obtenir une autorisation de reproduction (notamment pour les usages commerciaux).
- Sollicitez l’accord du propriétaire si la prise de vue a lieu sur un terrain privé ou si l’image sera associée à une marque, un produit ou une campagne publicitaire.
- Rédigez un contrat de cession de droits clair en cas de commande photographique, précisant les usages prévus de l’image, les droits cédés et les éventuelles limitations.
c. Sécuriser les usages éditoriaux et commerciaux
Les photographes et agences doivent toujours conserver une traçabilité des autorisations obtenues (mails, contrats, formulaires). En cas de litige, cela permet de prouver la bonne foi et de limiter les risques juridiques.
Pour les entreprises qui achètent ou exploitent des visuels, il est conseillé de :
- Vérifier les droits liés aux images (stock, banque d’image, commande),
- Éviter les montages ou détournements de bâtiments sans autorisation,
- Prévoir une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les atteintes potentielles au droit d’auteur ou à la vie privée.
d. Se faire accompagner si besoin
En cas de doute sur la légalité d’une photo ou sur l’étendue des droits à obtenir, mieux vaut consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, ou travailler avec des photographes expérimentés maîtrisant ces enjeux. Cela évite bien des complications lors de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des images.
Conclusion
Photographier un bâtiment peut sembler anodin, mais la diffusion de son image (notamment à des fins commerciales) est encadrée par des règles juridiques précises. Droit d’auteur de l’architecte, droits du propriétaire, liberté de panorama limitée : chaque situation exige une analyse au cas par cas.
Pour les photographes comme pour les entreprises, respecter ces droits n’est pas seulement une obligation légale, c’est aussi une marque de professionnalisme et de sérieux. En anticipant les autorisations, en encadrant les usages par contrat, et en restant informé des évolutions législatives, il est tout à fait possible de mener des projets visuels ambitieux en toute sécurité.
Enfin, s’entourer de partenaires compétents, comme Rétines est souvent la meilleure façon d’allier créativité visuelle et conformité juridique.
Jérémy Carlo est responsable de publication chez Rétines, où il veille avec l'équipe Rétines à la cohérence éditoriale de l’ensemble des contenus produits par le studio.
Contact
Nous sommes à votre disposition.
Briefez-nous grâce à ce formulaire, ou bien par e-mail à [email protected].